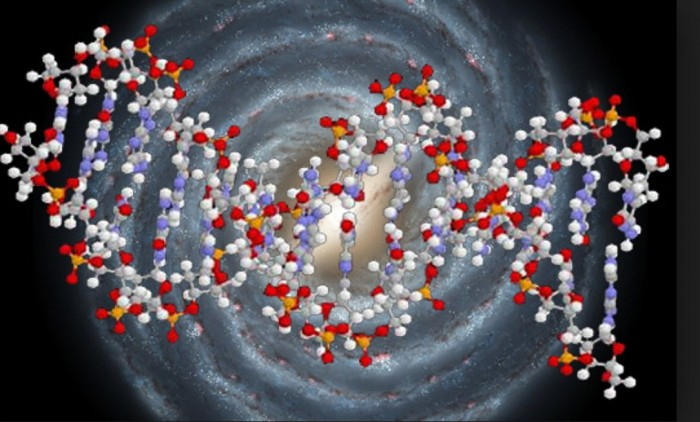Suite de : https://tarotpsychologique.wordpress.com/2015/04/08/lintelligence-symbolique-du-corps/
N.C. : Il y a donc des universaux, mais savoir ce qu’une maladie exprime réellement est avant tout un travail de prise de conscience individuelle ?
O.S. : Oui. D’autant plus que la question n’est pas seulement de savoir quel problème vient signaler la maladie, quelle incohérence entre les différents niveaux de l’être elle dénonce. Il s’agit aussi de trouver le mouvement, en moi-même, qui est en difficulté : qu’est-ce qu’il faut travailler, faire évoluer, changer – ou ne pas changer ?
Beaucoup d’écrits, ces derniers temps, ont abordé le sens des maladies, mais ils nous limitent souvent à une vision animale « biologique » qui nous ramène au niveau physiologique de la survie. La question centrale – et spécifique à notre époque, me semble-t-il – est selon moi, plutôt celle-ci : qui parle quand je suis malade ?
Et quand nous guérissons, qui guérit ? Est-ce notre part animale qui cherche à survivre ? Ou notre histoire personnelle et notre héritage transgénérationnel ? Ou encore notre être essentiel, qui tient à s’exprimer au travers de tout cela et vient nous proposer une initiation ?
Je pense que nous sommes malades de ne pas être ce que nous sommes vraiment, de ne pas nous accomplir totalement. Le corps le supporte pendant un temps, puis il envoie des messages d’alarme. C’est ainsi qu’il faut comprendre la phrase de Jung : « Vous ne guérirez pas de vos maladies, ce sont vos maladies qui vous guériront. »
Tout se passe comme si à un endroit de nous se trouvait la conscience de ce que nous pouvons être, et quand nous nous en éloignons trop, cette conscience nous parle et nous fait tomber malade. J’appelle cela « le saint homme qui marche dans le symptôme » : quel accomplissement notre être profond vise-t-il ?
N.C. : Ce serait cela, le propre de l’humanité : chaque personne serait un psychosoma cherchant à écrire une histoire singulière sur une page blanche ?
O.S. : L’animal n’a rien, ou très peu, à écrire : il ne change pas dans le cadre d’une génération. Les pattes du kangourou ont mis des millions d’années à rétrécir. Il est lion ou souris, ni méchant ni gentil, il est comme ça, c’est tout. Vous connaissez l’histoire de l’homme qui se retrouve sur le point de se faire dévorer par un ours, et qui prie le Seigneur d’accorder des sentiments chrétiens à son agresseur ? Il voit alors l’ours faire le signe de croix et remercier Dieu… de lui avoir procuré un bon repas !
Un ours reste un ours et c’est normal. Ni bien, ni mal. L’être humain, lui, est libre, il peut remettre en question la justesse de ses actes, la pertinence de ses croyances. Je crois donc en l’idée (sartrienne ou chrétienne !) de la page blanche, qu’il faut cependant nuancer. L’être humain a une part libre, qu’il lui appartient d’écrire et qui lui permet d’avancer à l’intérieur de sa génération.
Cette part est communément appelée la liberté humaine ou libre arbitre. Cependant, dès la naissance, elle est partiellement envahie par les règles écrites par l’histoire et par les générations précédentes. L’homme a la mission personnelle de se réapproprier ces pages pour les changer ou les rechoisir et augmenter ainsi l’espace libre.
N.C. : Et au niveau collectif ? Les épidémies aussi seraient des « messages » ?
O.S. : Pour aborder le problème des épidémies, il faut parler des microbes, ces co-facteurs fondamentaux de la vie. Le microbe est à la fois ce qui va nous aider, nous confronter, nous tester, travailler pour nous. Prenons le staphylocoque, par exemple. Il est le gardien de la porte, défendant et testant notre intégrité en permanence.
Nous en avons plusieurs centaines de millions sur la peau, blancs ou dorés, qui interviennent dès que celle-ci est agressée par une coupure, une écharde, etc., provoquant une réaction, avec arrivée massive de globules blancs, création de pus, d’un abcès, jusqu’à élimination du corps étranger.
Qui se montre particulièrement sensible aux staphylocoques ? Les malades opérés, les enfants en réanimation néonatale, les adolescents en évolution sur leur image corporelle (l’acné, c’est du staphylo). De façon générale, le staphylocoque signale donc des problèmes d’intégrité. On comprend que symboliquement, il soit lié au père protecteur ou à la mère nourricière.
Et c’est un autre microbe, le streptocoque, qui est lié au père initiateur ou à la mère initiatrice. Car un enfant n’a pas seulement besoin d’être protégé, il lui faut aussi un parent initiateur, pour rencontrer la difficulté, la surmonter au prix d’une épreuve, et apprendre à se déployer – « strepto », en grec, signifie « plié ». Les rhumatismes articulaires aigus, certaines maladies cardio-vasculaires et rénales, sont des maladies à streptocoques.
Elles touchent l’axe fondamental rein-cœur des acupuncteurs : identité (rein) + amour (cœur), souvent en difficulté, surtout si l’on n’a pas pu déployer certaines parties de soi au travers d’expériences et avec l’aide d’une fonction d’initiation.
L’épidémie joue le même rôle de confrontateur que le microbe, mais à l’échelle de l’humanité, qu’elle vient confronter à un problème précis. La grippe, par exemple, vient régulièrement questionner chacun dans sa gestion des problèmes trangénérationnels. La peste noire, à la fin du Moyen-Âge, vient poser la question de l’amour et de l’indifférence, au moment où on entre dans l’individuation des êtres humains, sortant du groupe-masse où la vie n’a pas de valeur.
C’est la question du rat – la partie de nous-mêmes qui ne vit que pour soi : comment gérer une société d’individus ne vivant que pour eux-mêmes, si ce n’est par l’amour ? Camus décrit bien, au début de son livre La Peste, un monde de chacun vers soi. La tuberculose, massive au XIX° siècle, pose la question du changement de mode de vie : comment survivre dans des conditions nouvelles ? Ce problème se pose encore aujourd’hui, notamment aux émigrants.
N.C. : Vous pensez donc que ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui, les épidémies s’attaquent au système immunitaire, au moment où l’individualisme est au programme ?
O.S. : L’immunité, scientifiquement, c’est la définition même de l’identité : elle définit le soi et le non-soi. Les maladies auto-immunes traduisent comme une guerre civile intérieure entre les parties de moi. L’organisme s’est bâti de telle manière qu’une partie ne reconnaît pas l’autre et l’attaque.
Or, on se constitue par le contact avec l’autre, qui est souvent microbien. L’immunité est un soi qui se construit dans la réalité et la confrontation à la vie. L’évitement systématique des infections les plus bénignes, que l’on appelle aujourd’hui « l’hypothèse hygiéniste », risque de ne pas permettre à l’organisme de se trouver en situation de confrontation. Le soi immunitaire n’y retrouve plus ses petits. Si je reprends votre question, l’individualisme serait un soi isolé, sans confrontation et courant le risque de ne pas avoir de sens.
N.C. : Mais donner autant de sens aux maladies, n’est-ce pas très culpabilisant ?
O.S. : Quand on s’engage dans cette réflexion, on rencontre forcément le problème de la culpabilité et de la responsabilité. Parce qu’il n’a pas toute l’information, le malade tend à déléguer les responsabilités à ceux qui savent, le personnel médical, le médecin. La tentation est grande de se dire qu’il n’y a rien à comprendre.
Certaines personnes souhaitent ne pas aborder d’autres sens de la maladie, et la médecine répond parfaitement bien à leur demande dans sa prise en charge. Pour d’autres personnes, c’est psychologiquement et ontologiquement insatisfaisant. De plus, la véritable prévention, celle qui permettra un jour d’enrayer la progression des coûts médicaux, relèvera probablement d’une attention et d’un soin à soi-même, et à sa lignée.
Ce n’est pas une idée nouvelle, mais une idée à redécouvrir. Les Chinois en ont parlé il y a trois mille ans : « Attendre d’être malade pour se soigner, c’est attendre d’avoir soif pour creuser un puits. » On retrouve le problème de la connaissance dont nous avons parlé : si je peux l’entendre, elle me responsabilise, me donne une autre possibilité. Chacun doit pouvoir aller chercher le sens au fur et à mesure de son besoin, et de sa capacité à entendre pour ne pas être écrasé par la culpabilité – la médecine assurant, elle, le maximum de moyens techniques pour chacun et quoi qu’il en soit.
N.C. : Comment franchir le pas entre prendre conscience de quelque chose et vraiment l’intégrer, de manière opérationnelle ?
O.S. : Notre conscience est multiple, notamment dans notre cerveau, où coexistent : l’instinctif reptilien, le dominant/dominé paléolimbique, l’émotionnel néolimbique, qui agit de concert avec la part « officiellement consciente », le cortex. Au grand dam des cartésiens, tous ces niveaux, nos instincts, nos sensations, nos émotions, notre conscience réfléchie sont en interaction permanente ( L’erreur de Descartes, Pr. Antonio Damasio, éd. Odile Jacob, 1995.).
Il faut ici dépasser la classique séparation entre cerveau droit et gauche, intuition et raison. La vraie clef semble plutôt dans la partie antérieure des deux hémisphères : le préfrontal, où s’élaborent les processus les plus complexes.
C’est le siège de cette partie de nous qui sait avant que nous sachions, cette petite voix intuitive qui nous dit quand nous sommes sur la voie juste, qui nous fait faire des découvertes… et qui s’agite quand nous sommes angoissés, nous envoyant le signal que nous sommes en train de nous tromper, de nous mentir, de nous fourvoyer.
Mieux vaudrait alors l’écouter, plutôt que de la faire taire avec des tranquillisants, qui agissent à ce niveau en déconnectant le cerveau préfrontal. Mieux vaudrait développer celui-ci – car il existe des méthodes pour cela – plutôt que de saboter cette tête chercheuse par des injonctions comme « surtout ne fais pas plusieurs choses à la fois », « ne change pas tout le temps de sujet », etc.
L’humour, le jeu, la création spontanée nourrissent la conscience du préfrontal. Se laisser guider par ce qui arrive, écouter son intuition, découvrir des liens surprenants, voilà des démarches tout aussi créatrices et génératrice de solutions et de conscience. Car si l’ange habite en nous quelque part, c’est dans le préfrontal !
Entretien avec le docteur Olivier Soulier par Sylvain Michelet pour le magazine Clé